La destruction des idoles : Interview avec Aaron Tugendhaft

The ancient city of Palmyra, in present-day Syria, which was severely damaged by IS in 2015
Par Danielle Charette et Atman Mehta. Traduction par Justin Saint-Loubert Bie.
Nous nous sommes entretenus avec Aaron Tugendhaft à propos de son livre, La destruction des idoles : D’Abraham à l’État islamique, publié chez Labor et Fides (2022) et traduit depuis l’anglais par Daniel Barbu. Cet entretien est paru pour la première fois en anglais sur Tocqueville 21.
Notre conversation porte notamment sur la politique de l’iconoclasme. Pourquoi une politique saine a-t-elle besoin d’images? Que pourraient impliquer les conclusions de Tugendhaft par rapport aux défis de la démocratie aujourd’hui ? La traduction ci-dessous est légèrement éditée pour des questions de clarté.
Danielle Charette : La destruction des idoles est un livre court mais d’une portée incroyable, touchant à Nimroud et à Saddam Hussein, à Al-Farabi et à Facebook. L’événement central est la destruction de sculptures du musée de Mossoul par des membres de l’État Islamique en 2015. Pouvez-vous nous dire pourquoi cet événement a autant captivé votre attention ?
Aaron Tugendhaft : J’ai vu pour la première fois la vidéo du musée de Mossoul sur Facebook, publiée par plusieurs de mes collègues qui étudient le Proche-Orient ancien. J’ai été immédiatement frappé par la similitude entre un instant de la vidéo et la scène d’un ancien relief assyrien situé dans le palais de Sargon II à Khorsabad. Tous deux, la vidéo et le relief, représentent trois hommes brisant la sculpture d’un roi allongé sur le sol. (Je connaissais cette sculpture en relief parce que je l’avais choisie pour la couverture d’Idol Anxiety, un ouvrage que j’ai co-dirigé il y a plusieurs années.) Bien que séparées de plus de 2.500 ans, les deux images furent réalisées à seulement 25 kilomètres l’une de l’autre. Cette ressemblance étonnante m’a fait réfléchir, et c’est finalement ce qui m’a poussé à écrire le livre. Le but n’a jamais été « d’expliquer l’État Islamique », mais plutôt de construire une série de réflexions autour de cette vidéo qui pourraient nous conduire vers une meilleure compréhension de nous-mêmes.
Atman Mehta : Le rapport entre la politique et les images semble être au cœur du livre. Vous soutenez que toute conception de la politique qui ne prend en compte le rôle des images est, soit une conception erronée, soit une conception qui définit les « images » trop étroitement. Pourquoi la politique a-t-elle besoin d’images ?
Aaron Tugendhaft : Parce que les images définissent les paramètres de nos vies politiques. J’aborde la question avec l’aide du philosophe médiéval Al-Farabi. Dans ses écrits sur la politique, Al-Farabi imagine un prophète-législateur qui fournit à son peuple des images aidant les individus à cultiver des engagements et des idéaux partagés, afin qu’ils puissent s’unir avec les autres au sein d’un corps politique. Cultiver ces engagements et ces idéaux : la loi seule ne peut y parvenir, car ces règles sont vécues comme un affront à la liberté individuelle. À moins que les individus en intériorisent le besoin par un engagement vis-à-vis d’un bien commun supérieur. Les images prophétiques nous aident donc à imaginer ce bien d’une manière qui nous unit en tant que communauté. Elles nous permettent d’aimer la Loi. Sans elles, la vie politique serait impossible — ou bâtie uniquement par la violence, ce qui revient au même.
Ainsi, les images sont tout ce qui peut aider à façonner l’imaginaire des individus vers une idée directrice commune. Leur signification est un produit de l’art humain, et pas de la nature pure. (La matière première qui constitue le mont Fuji existe sans doute à l’état purement naturel, mais en tant qu’image, le mont Fuji compte dans l’imaginaire japonais grâce à l’action humaine.) Un choix est toujours fait : certains aspects du monde — que ce soit la nature ou un fait historique — sont désignés comme ayant une importance politique, alors que d’autres ne le sont pas. L’idée même que la politique nécessite des images implique que l’ordre naturel des choses n’est pas suffisant pour ancrer la vie politique — qu’il est impossible de simplement laisser les faits parler par eux-mêmes. Cet aspect fabriqué des images peut générer de l’appréhension. Les images risquent d’être perçues comme fausses (comme des « idoles ») et l’on pourrait alors chercher à les écarter au nom de la véracité. Cette volonté d’échapper aux images, de détruire les idoles, met en péril la vie politique. C’est le résultat d’une fausse conception, néanmoins bien répandue, de ce que l’humain est capable d’accomplir en politique sans images.
Danielle Charette : Le livre est issu de votre double formation en études du Proche-Orient ancien et en théorie politique comparée. Mais il est question également d’un élément personnel. Le livre est dédié à votre « famille irakienne ». Pouvez-vous nous parler de ce lien ?
Aaron Tugendhaft: Bien que mon nom de famille ne l’indique guère, j’ai des origines irakiennes. Mon grand-père maternel est né à Bagdad dans une communauté juive qui vivait le long du Tigre depuis l’Antiquité. Jeune homme, il participa au projet collectif de la construction d’un État moderne Irakien — aux côtés de musulmans sunnites et chiites, de chrétiens, de Kurdes, de marxistes et d’autres. L’Irak était un lieu d’une diversité incroyable, d’un point de vue culturel et religieux. Malheureusement, des mouvements d’homogénéisation se sont périodiquement heurtés à cette pluralité. Dans le cas de mon grand-père, il a quitté Bagdad pour Téhéran à cause du Farhoud, le pogrom commis à l’encontre des Juifs de Bagdad en juin 1941. Ma mère est née à Téhéran, et de là mon grand-père emmena sa famille à Tel-Aviv, et enfin à New York. Cet élément personnel motive certainement mon intérêt théorique pour la façon dont les gens maintiennent la pluralité dans des communautés politiques.
Cette volonté d’échapper aux images, de détruire les idoles, met en péril la vie politique.
Danielle Charette: En parlant de patrimoine : dans votre chapitre sur les musées, vous notez qu’après la destruction du musée de Mossoul, un certain nombre d’organisations culturelles comme l’UNESCO ont condamné les actions de l’État Islamique comme une attaque contre notre « patrimoine commun ». Ces appels à un patrimoine partagé sont-ils utiles ?
Aaron Tugendhaft : Ces appels partent d’une bonne intention, mais je pense qu’ils sont finalement malavisés. L’idée d’un patrimoine humain partagé est enracinée dans le concept de « civilisation » comme quelque chose qui nous unirait profondément malgré nos divisions politiques. Cette idée peut sembler merveilleuse à première vue, mais je pense que son mépris implicite pour la politique est profondément troublant. Plutôt que de souligner les diverses manières avec lesquelles les divers groupes humains peuvent choisir d’organiser leur vie collective, cette idée met en valeur un courant sous-jacent qui traite ces différences politiques comme étant obsolètes. Au lieu d’avoir une offre politique diversifiée, elle ne nous offre qu’un choix manichéen : la « civilisation » contre la « barbarie ». Les barbares ne vivent pas une vie humaine différente de la nôtre comme les Britanniques se démarqueraient des Français. Les barbares sont inférieurs aux hommes, ce qui fait qu’il existe une différence qualitative entre une hostilité envers les barbares et une simple opposition politique. Selon ce raisonnement, ceux qui ne se conforment pas aux normes de la civilisation sont inadmissibles à celle-ci — ils deviennent l’objet d’une éradication plutôt que l’objet d’une confrontation politique.
L’État Islamique tente un projet similaire lorsqu’il prétend que le monde doit être divisé en deux groupes : les fidèles d’une part et les apostats de l’autre, sans « zone grise » entre les deux. Lorsque certains segments de la gauche prétendent combattre « toutes les formes d’oppression », ils réduisent la question à une opposition morale manichéenne qui s’intéresse plus à la pureté qu’à la politique. Dans tous ces exemples, on cherche à échapper au désordre de la politique. Pour combattre ce désir, nous devons apprendre à mieux percevoir les complexités que de telles explications simples ont tendance à nous cacher. Le deuxième chapitre de mon livre s’efforce à cette nuance en énumérant les nombreuses façons dont les anciennes sculptures irakiennes ont été incorporées dans des projets politiques en concurrence, ce qui complique l’idée d’un « patrimoine commun ».
Atman Mehta : Beaucoup de statues sont tombées aux États-Unis en 2020, et nous avons tous vu les images de l’attaque sur le Capitole le 6 janvier 2021. Le public américain semble s’interroger sur son identité en tant que corps politique. Existe-t-il un moyen pour le public d’intéragir avec les images d’une manière plus productive ?
Aaron Tugendhaft : Il ne faut pas oublier que l’iconoclasme est en soi une façon de produire de nouvelles images. Lorsqu’une statue est démolie et que cet acte est capturé sous forme de photographie ou de vidéo, nous avons affaire à une prestation qui a pour objectif d’être vue. La nouvelle image vient remplacer l’ancienne. Nous ne devons pas seulement pouvoir juger si une statue est appropriée en tant qu’image politique, nous devons aussi évaluer la portée des nouvelles images qui sont en train de les remplacer. Il faut comprendre que ces images d’images détruites ont une portée politique, tout comme une statue de Robert E. Lee montant fièrement à cheval. Nous devons être plus attentifs au fonctionnement des images politiques et à pourquoi nous ne pouvons pas simplement dire, comme l’a fait David Olusoga dans un article pour The Guardian : « assez, maintenant, de ces mythes réconfortants ».
Danielle Charette : J’ai remarqué que le livre commence par une épigraphe de John Quincy Adams : « La démocratie n’a pas de monuments ; son essence même est iconoclaste ». Adams semblait penser que cette idée était libératrice. Or, les Américains semblent plutôt coupables d’iconoclasme ces derniers temps. Est-ce le signe d’une démocratie affaiblie ?
Aaron Tugendhaft : Je ne pense pas qu’on puisse avoir une politique saine dont l’essence est iconoclaste. Croire que c’est possible, c’est ignorer des réalités humaines et politiques fondamentales. Cependant, il est possible de dresser l’iconoclasme comme un idéal pour une communauté politique — de faire de l’image iconoclaste sa principale image politique. C’est peut-être ce que John Quincy Adams essayait de dire à propos de la démocratie. L’Islam accomplit quelque chose de similaire dans ses histoires et images du jeune Ibrahim brisant les images de ses voisins. L’Islam n’échappe pas pour autant aux images ; au contraire, l’image d’Ibrahim l’iconoclaste devient essentielle à la construction de son identité. Ainsi, la vraie question à poser à John Quincy Adams n’est pas de savoir si la démocratie est fondamentalement iconoclaste mais s’il est sain de faire de l’image iconoclaste son idéal politique.
Le livre comprend une deuxième épigraphe d’Ibn Arabi, mystique soufi du XIIème siècle : « L’incapacité d’Harun (c’est-à-dire « Aaron » dans la Bible) à maîtriser les disciples du veau d’or … était une chose sage rendue manifeste dans le réel : qu’Il soit adoré sous toutes les formes ». L’espace où nous devons construire ensemble notre vie politique se situerait quelque part entre l’idéal de servir Dieu à travers toute image créée par l’homme, et la croyance que la démocratie peut fonctionner sans aucune image.
Atman Mehta : J’ai été frappé par votre discussion du jugement. La vie politique a besoin de médiation. Comment les citoyens peuvent-ils intéragir avec les images de manière plus productive ?
Aaron Tugendhaft : Dans son schéma, Al-Farabi dépeint un prophète sage qui sait quelles images seraient les meilleures pour une certaine communauté politique. Le prophète les fournit au peuple, et voilà tout. Aujourd’hui, pour nous, ce n’est pas si facile que cela. En tant que citoyens en démocratie, nous héritons certainement d’images qui nous ont été transmises ; or nous sommes impliqués non seulement dans la consommation de nos images mais aussi dans leur production. Cela signifie que le cadre dans lequel nous pouvons agir en tant que citoyens est en constante évolution et ouvert à la ré-interprétation. En toute évidence, l’Amérique traverse aujourd’hui un moment de lutte intense au sujet de ses images — qu’il s’agisse du renversement (à mon avis idoine) des statues confédérées, ou du changement de nom d’écoles publiques à San Francisco. Nous ne pouvons pas éviter de préférer nous entourer de certaines images plutôt que d’autres, mais nous pouvons modérer nos attentes et, ainsi, contenir l’élan iconoclaste.
Le livre se termine par une discussion du texte de Nietzsche, le Crépuscule des idoles ou Comment on philosophe avec un marteau. Nietzsche suggère que nous pouvons manier un marteau comme un diapason et tapoter des images au lieu de les briser. C’est aussi une alternative à la soumission aux images. Le tapotage de Nietzsche est une manière de philosopher. Mais nous pourrions aussi nous en inspirer pour penser la citoyenneté démocratique. Les citoyens libres ont peut-être besoin de garder suffisamment de distance par rapport à leurs images politiques afin de s’engager dans la réflexion et le jugement, tout en restant suffisamment modérés pour renoncer à la tendance iconoclaste qui cherche un régime sans images imparfaites. Dans ce cas-là, nous devrions devenir de meilleurs tapoteurs. Ainsi, nous pouvons entrechoquer les images. Chaque image expose quelque chose laissée cachée par une autre. C’est une procédure que j’utilise tout au long de mon livre.
Atman Mehta : Le livre contient également un argument sur les algorithmes des réseaux sociaux. Ces algorithmes font-ils obstacle à notre faculté de juger ?
Aaron Tugendhaft : Aujourd’hui, bien que les débats continuent autour de sujets comme les monuments dans les parcs publics, le principal lieu de circulation d’images politiques sont les réseaux sociaux. Ces images numériques nous marquent fortement, en partie parce que nous les vivons comme éphémères et non comme un objet d’inquiétude. Mais si nous n’arrivons pas à comprendre la nature des plateformes en ligne comme véhicules de diffusion d’images politiques, nous serons de plus en plus à leur merci. Cela parut évident lors d’une séance du Comité judiciaire du Sénat américain. En interrogeant Mark Zuckerberg et Jack Dorsey, la plupart des sénateurs ont fait référence aux réseaux sociaux comme s’il s’agissait simplement de nouvelles versions de journaux, de la télévision et de la radio, sans reconnaître comment les algorithmes ont transformé la distribution de l’information.
Mon troisième chapitre se termine par une discussion de ce que j’appelle « l’iconoclasme algorithmique ». Si l’iconoclasme vise à débarrasser notre monde d’images vexantes, le claquement de nos doigts sur le clavier est devenu plus puissant que n’importe quel marteau. Plus nous « aimons » ou partageons — ou même nous attardons sur un type d’image — plus nous verrons des images similaires sur nos écrans. Plus nous interagissons avec nos mondes en ligne, moins des images en contradiction avec nos sensibilités apparaîtront sur nos écrans. Ces mondes virtuels offrent un répit de la réalité têtue de la politique : nous vivons avec des gens qui ne sont pas d’accord avec nous. Il est attirant d’habiter dans un tel monde. Et donc, nous continuons à nous pencher sur nos écrans. Et à chaque clic l’iconoclasme s’intensifie.
Photo Credits: Columns and tombs in Palmyra, by Erik Albers (CC0) via Wikimedia Commons.
Couverture de livre: La destruction des idoles (Labor et Fides, 2022)

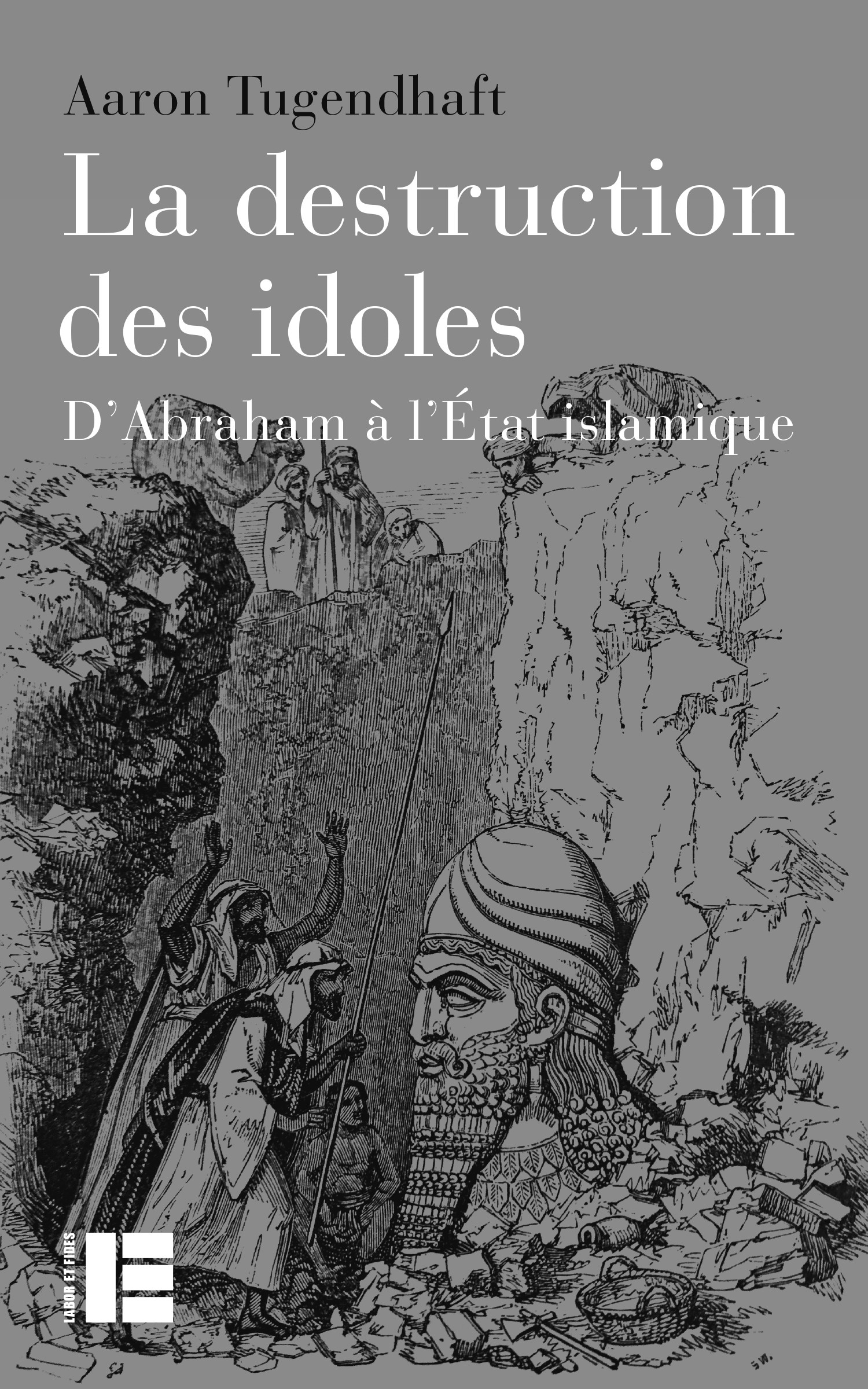
2 Comments
Congratulation Aaron for your New book
Très intéressant commentaire de ton livre important. Merci d’avoir fait une traduction française ce qui me rend la lecture plus facile.
Comment diffuser davantage ton livre et son commentaire???